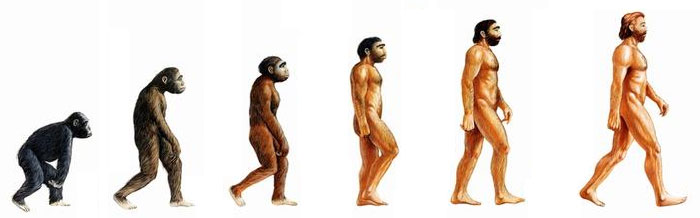Plus de neuf embauches sur dix se font désormais sous la forme d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat d’intérim, avec des missions de plus en plus courtes, 26 jours en moyenne par mission en 2011. Une précarité croissante depuis 30 ans qui touche principalement les jeunes et désormais les seniors, à en croire une récente étude de l’Insee. http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/les-cdd-toujours-plus-nombreux-et-de-plus-en-plus-courts-962349#xtor=EPR-226
Archives de catégorie : social
Un contrôle d’alcoolémie est-il licite dans l’entreprise ?
M. X…, engagé le 1er février 1999 en qualité de conditionneur par la société S, aux droits de laquelle est venue la société ND Log.
Monsieur X… est licencié pour faute grave le 23 décembre 2008, après un alcootest qui s’est révélé positif.
Si le salarié a reconnu avoir bu la veille au soir et n’a pas contesté le résultat, il soutenait néanmoins qu’il était tout à fait apte à travailler.
Il a alors saisi la juridiction prud’homale et la Cour d’appel a condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail.
Pour la Cour d’appel, le contrôle d’alcoolémie n’était pas conforme au règlement intérieur dès lors que l’alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié présentait un état d’ébriété apparent et dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse.
Pour l’employeur, ce contrôle était conforme à l’article 1er du règlement intérieur et, selon l’article 10, l’état d’ébriété est une infraction à ce règlement, compte tenu des risques pour la sécurité du fait qu’il est amené à conduire un engin de manutention, qui justifie un licenciement pour faute grave.
Pour Monsieur X… , ce contrôle n’était pas conforme au règlement intérieur qui prévoit que : « Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l’exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation ; le salarié pourra demander à être assisté d’un tiers et à bénéficier d’une contre-expertise ».
Il en résulte que l’alcootest ne peut être pratiqué qu’en cas d’état d’ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse.
En l’espèce, rien ne permettait de dire qu’il ait présenté un état d’ébriété apparent.
Le fait que le contrôle ait été pratiqué sur les 18 personnes d’un service démontre le contraire.
Dès lors ce dépistage n’étant pas conforme au règlement intérieur, son résultat ne constitue pas une faute.
Cette position, confirmée par la Cour d’appel est également validée par la Cour de cassation qui rappelle que l’employeur ne pouvait, selon le règlement intérieur, soumettre le salarié à un contrôle d’alcoolémie, dans le but de faire cesser immédiatement la situation, que si le salarié présentait un état d’ébriété apparent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que pour être licite, un dépistage d’alcoolémie doit être effectué conformément au règlement intérieur de l’entreprise.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 2 juillet 2014 N° de pourvoi: 13-13757 Non publié
et http://www.capital.fr/carriere-management/conseils-juridiques/peut-on-bannir-l-alcool-des-locaux-de-l-entreprise-826187#xtor=EPR-226
Le préavis est-il dû en cas de licenciement pour inaptitude?
On savait déjà que l’indemnité de licenciement était doublée et que le préavis était dû en cas de licenciement consécutif à un accident du travail. Le préavis est-il dû en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle non consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle ?
En cas de maladie « simple », cette rupture prend la forme d’un licenciement. La procédure de licenciement pour motif personnel doit être appliquée et l’indemnité légale de licenciement (ou conventionnelle dès lors que les clauses de la convention ne l’excluent pas) doit être versée. Si le licenciement concerne un salarié dont l’inaptitude est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Dans ce cas, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, sauf si elle est expressément prévue par la convention collective (ce qui n’est pas le cas dans le transport) ou selon les tribunaux, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Le paiement du préavis n’est donc pas « obligatoire », mais conseillé si l’employeur n’a pas été en mesure de proposé un poste de reclassement.
En revanche s’il l’a fait et que le salarié l’a refusé (ce qui est son droit), l’employeur a bien satisfait à son obligation de reclassement et dans ce cas le préavis n’est pas dû!
Pour en savoir plus, voilà ce que dit le ministère du travail : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/sante-conditions-de-travail,115/les-consequences-de-l-inaptitude,1060.html
Vers une majoration du travail de nuit en déménagement ?
Plusieurs fois abordé ici, les négociations paritaires nationales en déménagement ont repris ce 11 septembre sur la question de l’inaptitude à la conduite et sur l’indexation de la prime pour travail de nuit. http://viguiesm.fr/faut-il-majorer-la-prime-de-nuit-en-demenagement-et-creer-une-prevoyance-specifique-demenagement/
Mais le vrai problème du travail de nuit (plutôt que quelques centimes sur la prime), c’est la question de la durée du travail limitée à 10 heures, du temps de service de 12 heures et l’amplitude autorisée de 16 heures en déménagement et de l’articulation avec le travail de jour, surtout quand on a commencé sa journée quelques minutes avant 5 heures du matin !!
Le vrai problème, c’est le code du travail et l’Article L3312-1 du code des transports qui stipule: Lorsqu’un salarié appartenant au personnel roulant d’une entreprise de transport routier, à l’exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l’article L. 1321-7 ou lorsqu’il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
A chaque fois, c’est un risque de contravention de 5ème classe, soit 750 € pour quelques minutes empiétées sur l’amplitude nocturne. Le déménagement, du moins en saison devrait avoir une dérogation comme le sanitaire ! Voilà les vrais enjeux, pas une obole de quelques centimes pour réintégrer rétroactivement un indice d’actualisation 13 ans en arrière, avec toute la fragilité juridique qui s’impose ! 

Mais c’est vrai qu’on est mieux au 27ème étage d’une tour pour négocier (même un 11 septembre) qu’au 2ème sous sol. D’ailleurs chaque fois que l’on nous met au sous-sol, je crois que je vais demander une prime de nuit comme à la RATP !
http://viguiesm.fr/a-combien-dheures-damplitude-a-t-on-droit-quand-on-prend-son-service-la-nuit/
Les syndicats du transport sont de retour!
Les représentants des syndicats de salariés du transport se sont réunis le 9 septembre pour préparer les réunions paritaires à venir. Au programme: hausses de salaires, mais aussi une longue liste de revendications. Dans un courrier de trois pages envoyé au secrétaire d’Etat aux Transports, Thierry Douine, président fédéral de la CFTC, a souligné le fait que le « secteur du transport routier traverse une crise profonde et qu’un fort soutien du gouvernement est requis pour accompagner les organisations du secteur dans des solutions à long terme qui lui permettront de redonner confiance aux salariés et leur garantir leurs emplois ». La CFTC a proposé trois points : un déblocage des salaires (la dernière hausse remonte à deux ans et demi en transport routier !) et des compensations telle que la généralisation des tickets restaurants pour les salariés de la logistique, une garantie sur l’avenir des couvertures de protection sociale et l’amélioration des conditions de travail ! Sans doute de quoi alimenter le débats des assises de D&O la semaine prochaine ! http://viguiesm.fr/assises-du-transport-les-16-et-17-septembre-2014/.
Certains prévoient même une mobilisation pour le 16 octobre http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0203751533664-la-cgt-lance-un-appel-a-la-mobilisation-pour-le-16-octobre-1039502.php
Vous avez aimé Y, vous adorerez Z !
Maintes fois abordé ici, toujours beaucoup d’actualité sur ce conflit de générations appelées X, Y ou Z http://www.blog-emploi.com/generation-z/
et culture Y ? http://www.journaldunet.com/management/expert/58304/culture—y—–des-valeurs-qui-impactent-les-relations-de-travail-au-dela-de-la-generation—y.shtml?
Viguié Social Mobilité peut également certainement vous aider  en application de l’accord de prévention de la pénibilité à favoriser les « binômes juniors – seniors » et à favoriser l’intégration des « djeuns » dans vos entreprises en décryptant leur comportement et leurs attentes, de par ses 25 ans d’expérience professionnelle… d’expérience des réseaux sociaux et de père !
en application de l’accord de prévention de la pénibilité à favoriser les « binômes juniors – seniors » et à favoriser l’intégration des « djeuns » dans vos entreprises en décryptant leur comportement et leurs attentes, de par ses 25 ans d’expérience professionnelle… d’expérience des réseaux sociaux et de père !
Et voir aussi
Le défaut de formation peut coûter cher !
Certaines entreprises semblent parfois oublier de former certains de leurs salariés en formation continue, un manquement à la législation qui peut leur coûter cher. La formation est un investissement sur le futur, mais pas seulement !
La Cour de cassation a rendu des arrêts le 7 mai et 18 juin derniers condamnant des entreprises pour défaut de formation professionnelle. Cette décision n’est pas une première.
Deux arrêts rendus sur la question
Le 5 juin 2013, la juridiction suprême s’était déjà prononcée sur le sujet. Dans un cas comme dans l’autre, on était dans une procédure de licenciement où le salarié, bien conseillé, avait mis en avant cet argument. Dans les deux cas, la Cour a analysé ce problème de formation indépendamment des causes du licenciement et l’entreprise a été condamnée. La Cour de cassation a relevé que les salariés présents dans l’entreprise n’avaient bénéficié d’aucun stage de formation continue, « ce qui établit un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et que cette situation les privant d’une meilleure adaptabilité à un futur emploi, il convient d’allouer la somme de 6.000 euros en réparation. » Il y a quand même une différence majeure entre les deux arrêts : en 2013, le défaut de formation portait sur une période de seize ans. En 2014, le délai n’est plus que de sept ans. Il se raccourcit donc fortement.
Ne pas former ses salariés est une faute juridique, mais aussi de gestion
Si les FCO et autres CACES par leur caractère obligatoire en matière de fréquence permettent de résoudre de facto le principe de la formation continue et de l’adaptation des conducteurs et manutentionnaires, il n’en va souvent pas de même sur d’autres formations obligatoires comme celle au monte-meubles ou à la formation obligatoire à la sécurité de 7 heures en déménagement (hygiène de vie et gestes et postures), voire pire quand elles sont facultatives !
Les autres catégories de personnel sont en effet également parfois négligés en termes de formations, notamment les exploitants, responsables SAV, commerciaux, chefs d’agence, etc. Concrètement, combien d’entre eux ont suivi des formations depuis leur embauche et combien sont à jour des subtilités du règlement 561-2006, de la partie sociale du code des transports, des contrats types, du calcul de coût de revient ou de la manière de manager en 2014 une équipe?
L’autoformation n’est pas une réponse
La plupart se sont souvent « auto-formés », seuls ou avec des collègues. Ils ont aussi appris à maîtriser les nouvelles technologies et le potentiel que peuvent apporter les moteurs de recherche et forums de discussion pour trouver la « fausse bonne » réponse à la question qu’ils se posent. Mais tout cela est bien insuffisant par rapport aux exigences du code du travail qui précise entre autres que « l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré à l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation (art L6312-1) » et que « l’employeur veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (art L6321-1). » En plus, soyons réalistes : au-delà des seules obligations légales, ne pas former ses managers peut être une faute de gestion. Car ce n’est pas une dépense, mais bien un investissement sur le futur.
Avance sur salaire et acompte
Il est parfois difficile, pour diverses raisons, par exemple dans cette période de réception des avis d’imposition, où à un moment où les heures supplémentaires se font moins nombreuses, d’attendre la fin du mois pour percevoir son salaire. Par définition, le salaire est versé en contrepartie d’un travail. Cependant, il existe deux types de solutions pour répondre à cette problématique : l’avance et l’acompte sur salaire. Comment accorder ces sommes et quelles sont les règles de paie pour les récupérer ?
Une avance sur salaire correspond à un prêt consenti par l’entreprise. En effet, la somme attribuée au salarié correspond à un travail non encore effectué. Cette somme peut être versée par chèque, par virement ou en espèces. Vous n’avez pas l’obligation de répondre favorablement à une demande d’avance sur salaire.
Si vous acceptez la demande, il est préférable d’établir une convention venant préciser le montant de l’avance, la date de versement, ainsi que les modalités de remboursement, ci-joint un modèle
Engagement de remboursement d’une avance sur salaire
Faisant suite à la demande de M. ……, la société …… lui accorde à titre individuel et exceptionnel, une avance sur salaire d’un montant de …… remise ce jour par chèque n°…….
Cette avance sur salaire est remboursable sans intérêts.
A cet effet M. …… s’engage à verser par chèque ou virement bancaire sur le compte de l’entreprise le …… de chaque mois la somme de …… et ce jusqu’à extinction de la dette.
Au cas où une échéance ne serait pas honorée par M. ……, la société se réserve la possibilité de mettre en place un prélèvement sur salaire (règle du 1/10e) à chaque échéance de paie et ce jusqu’à extinction de la dette.
M. …… pourra également se libérer par remboursements anticipés.
En cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles et seront prélevées sur le bulletin de paie dans les limites mentionnées ci-dessus ou payées dans leur intégralité directement par le salarié.
Fait à ……, le ……, en deux exemplaires.
Signature du salarié Signature de l’employeur
Quel délai pour notifier un licenciement après une mise à pied conservatoire ?
La prudence est de mise dès lors que la Cour de Cassation considère que lorsque la procédure de licenciement est engagée 6 jours, voire même 4 jours après la notification d’une mise à pied conservatoire, cette dernière prend un caractère disciplinaire et le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 30 octobre 2013, n°12-22.962 et 14 novembre 2013, n°12-17.903).
Par engagement de la procédure de licenciement, il faut entendre la date d’expédition postale ou de remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non sa date d’envoi).
Le raisonnement tenu par la Haute juridiction résulte de l’application de la règle «non bis in idem», l’empêchant de sanctionner une seconde fois l’intéressé pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement, ce dernier étant alors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La position de la Cour de cassation est constante à ce sujet : la mise à pied d’un salarié ne peut revêtir un caractère conservatoire que si elle est prononcée de manière concomitante à l’engagement de la procédure de licenciement (Cass. soc., 15 avril 2008, n° 06-46.037), ou très rapidement suivie de l’engagement de la procédure (Cass. soc., 13 février 2008, n° 06-42.969 ; Cass. soc., 20 mars 2013, n°12-15.707).
Une seule exception existe à cette règle : lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l’exercice de poursuites pénales, l’employeur peut alors, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-27.508).
En conclusion, il est préférable de notifier la mise à pied conservatoire concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement.
Les jeunes pères sont protégés pendant quatre semaines contre le licenciement
Pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de son enfant, le jeune père ne peut être licencié que s’il commet une faute grave ou si le maintien de son contrat de travail est impossible.
Une protection contre la rupture du contrat de travail est instituée au bénéfice des jeunes pères salariés par le nouvel article L 1225-4-1 du Code du travail.
Cette protection est accordée pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, que le salarié choisisse de s’absenter – dans le cadre du congé de naissance, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congés payés – ou qu’il soit présent dans l’entreprise au cours de cette période.
L’objectif de cette mesure est d’empêcher que la situation de famille du salarié ou le fait qu’il prenne son congé de paternité devienne un motif, même inavoué, de licenciement
pour en savoir plus: peres protégés contre licenciement VSM